III. Partie pratique
A. Présentation générale
J'ai mené l'expérimentation à l'école Cuvier de Toulouse. Cette école fait partie d'un réseau d'aide couvrant quatre groupes scolaires. Les membres du réseau sont au nombre de quatre : une psychologue, une rééducatrice et deux institutrices à mi temps sur un poste E. Faisant fonction de maître E, je complète le mi-temps de ma collègue titulaire. Nous travaillons chacune sur deux groupes scolaires et nous nous retrouvons chaque semaine avec la rééducatrice et la psychologue pour une réunion de synthèse réseau.
J'ai effectué ma recherche avec un groupe d'adaptation de huit
élèves de CP. : Stéphanie, Helmi, Radouane, Andrès, Alexandra, Armand,
Loïc et Carène. Dans un premier temps, j'ai constitué deux groupes que
j'ai ensuite fusionnés pour que les échanges entre les élèves soient
plus nombreux. J'ai choisi ce groupe d'élèves car ils ont été les
premiers à être signalés par les enseignants pour des difficulté de
lecture. De plus, seule cette école propose une classe destinée
uniquement à l'adaptation et où le matériel et les expériences en
cours étaient en sécurité.
Lors de la synthèse, nous avions convenu de leur faire passer un test
pour connaître le profil de chaque enfant et de mettre en place
les projets d'aides spécialisés individuels.
Les séances ont débuté au mois d'octobre à raison de trois quarts d'heures à une heure deux fois par semaine.
6ans 2 mois
5 ans 11 mois
7 ans
6 ans 8 mois
5 ans 9 mois
6 ans 3 mois
5 ans 11 mois
5 ans 11 mois
Au vu de ces résultats, on s'aperçoit que la plupart des enfants sont très jeunes, de début d'année ou bien redoublants et encore fragiles ou encore d'origine étrangère. Trois d'entre eux ont particulièrement besoin d'un soutien au vu des résultats du test, les autres bien que le test se révèle positif, n'ont pas encore intégré tout ce que le travail scolaire implique (attention, écoute, organisation).
B. Démarche générale de l'expérimentation
1. Les expériences proposées :
Les élèves ont été confrontés à trois expériences
différentes mais ayant toujours le même thème : l'eau.
Expérience 1 : Comment faire pour récupérer le morceau de sucre
que je viens de plonger dans un verre d'eau et qui s'est dissout ?
(Apparemment, aux yeux des élèves, il a disparu.)
Expérience 2 : Comment faire pour que l'eau contenue dans le verre
parte plus vite ?
Expérience 3 : Comment faire pour que l'eau descendue dans le
verre ne descende plus ? (nous avions observé que le niveau de l'eau
baissait au bout d'un certain temps puis nous retrouvions un verre vide)
2. Déroulement des expériences :
- Je présente un phénomène courant mais curieux au groupe
d'élèves.
- Je demande de décrire ce qui est observable (à l'oral collectif puis
à l'écrit individuel avec schéma et annotations). J'aide les élèves
dans cette tâche en leur proposant des mots que j'écris au tableau, nous
élaborons ensemble un code : des vagues pour l'eau par exemple)
- Je pose la question qui représente la situation problème, l'obstacle
qui va faire que les élèves deviennent des petits chercheurs.
- S'ensuit une discussion collective où chacun donne son point de vue.
- Je demande à chaque élève de représenter ce qu'il compte faire pour
trouver une solution et d'exprimer ce qui peut se produire selon lui au
terme de l'expérience sur son cahier d'expérience
- J'écris ensuite
sous la dictée son hypothèse.
- Les élèves réalisent chacun leur expérience, ils mettent "la
main à la pâte" :
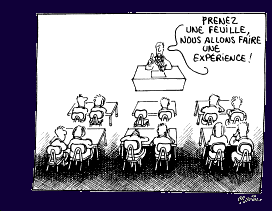
(humour)
- Nouvelle observation, compte rendu de l'expérience avec une nouvelle
représentation sur leur cahier des effets observés : schémas,
annotations.
- J'écris sous la dictée sur chaque cahier les commentaires s'ils sont
différents ou bien je transcris au tableau la remarque si elle est
générale. Les enfants font alors un travail de copie.
- Les données recueillies ont souvent pour résultat de nouvelles
représentations chez les élèves, elles suscitent de nouvelles questions
et de nouvelles expériences. On reprend alors le même processus.
- Si la situation bloque ou que les raisonnements sont erronés, je pose
alors un autre problème ou je propose une nouvelle expérience pour faire
évoluer les représentations vers un univers moins "magique".
C. Analyse des données :
Je vais tenter de regrouper les données selon les différents types de compétences transversales que je me propose de faire acquérir aux élèves.
Réflexion, Recherche : Émettre des suppositions, Faire
des choix et les expliquer, Contrôler ses réponses par rapport au projet
et aux données initiales.
Méthodes de travail : Appliquer les consignes de rigueur et de
présentation d'un travail (soin, mise en page, illustration...)
Traitement de l'information : Restituer et réorganiser les
informations réunies.
1. Réflexion, Recherche
a. Émettre des suppositions, faire des choix et les expliquer : quelques séances significatives.
![]() La première séance s'est révélée fort
intéressante car les enfants étaient désorientés par ce que je leur
proposais. La manière étant inhabituelle, ils ont d'abord gloussé puis
ri. Ensuite vinrent les remarques spontanées de leurs
représentations.
La première séance s'est révélée fort
intéressante car les enfants étaient désorientés par ce que je leur
proposais. La manière étant inhabituelle, ils ont d'abord gloussé puis
ri. Ensuite vinrent les remarques spontanées de leurs
représentations.
Ils prêtaient à l'eau des fonctions humaines : "L'eau a
mangé le sucre, elle l'a avalé", "Le sucre est parti dans le
ventre de l'eau" ou exprimaient leur vécu : "C'est
de la limonade" , "C'est du café" (on met du
sucre dans le café, la limonade est sucrée).
Voici les suppositions ou hypothèses émises ce jour là à la
question " Comment faire réapparaître le sucre ?" :
- "Il faut en mettre un autre" (Ils pensent donc que
le second sucre ne se dissoudra pas)
- "Il faut vider l'eau" (Le sucre s'est caché mais en
vidant l'eau, il ne pourra plus se cacher)
- "Il faut tourner à l'envers avec la cuillère" (en
tournant dans l'autre sens on inverserait le processus)
- "Il faut dire une formule magique : Abracadabra, sucre reviens
!"
Toutes ces expériences ont été vite réalisées et bien sur non
suivies d'effet. Enfin un élève a suggéré qu'on laisse le verre dans
un coin pendant longtemps, le sucre devrait bien revenir ! Tout le groupe
s'est rangé de son côté.
![]() Séances suivantes (1) : Nous nous
apercevons que l'eau descend petit à petit mais le sucre ne revient pas.
Enfin le sucre réapparaît collé au fond du verre. Par contre, il n'y a plus
d'eau.
Séances suivantes (1) : Nous nous
apercevons que l'eau descend petit à petit mais le sucre ne revient pas.
Enfin le sucre réapparaît collé au fond du verre. Par contre, il n'y a plus
d'eau.
Les explications proposées par les élèves sont de
trois ordres :
- Quelqu'un a bu ou renversé l'eau pendant notre absence.
- Le sucre a absorbé l'eau. Il a pris l'eau, il l'a bue.
- L'eau est partie dans les égouts mais on ne sait pas comment elle a
fait.
Les élèves pensent qu'une tierce personne est à l'origine de la
disparition de l'eau (elle l'a renversée, elle l'a bue). D'autres
attribuent les qualités d'une personne vivante à l'eau ou au sucre. (il
a bu l'eau). Certains n'ont pas d'explication.
![]() Séances suivantes (2) : Que faire pour
que l'eau contenue dans un verre descende plus vite ? et peu de temps
après : Comment faire pour que l'eau contenue dans le verre ne
descende pas ?
Séances suivantes (2) : Que faire pour
que l'eau contenue dans un verre descende plus vite ? et peu de temps
après : Comment faire pour que l'eau contenue dans le verre ne
descende pas ?
Pour que l'eau descende plus vite : on distingue
deux réponses : on utilise le radiateur de la classe ou bien le soleil.
Tous font référence à la chaleur.
Pour que l'eau ne descende plus, les avis sont plus partagés :
- les uns font référence au froid par opposition à la chaleur
(radiateur froid, mur froid)
- d'autres au noir par rapport à la lumière et à la chaleur du soleil
(une boîte fermée, l'ombre)
- une élève se distingue des autres car elle veut mettre un bouchon pour
empêcher l'eau de partir.
De plus, ils commencent à se distinguer les uns des autres, chacun essaie d'émettre un avis différent et de proposer sa propre expérience.
D'autres n'émettent pas d'hypothèse. Ils se rangent du côté de l'un ou l'autre de leurs camarades.
b. Contrôler ses réponses par rapport au projet et aux données initiales :
Au départ, les élèves prennent cette activité comme une compétition. Si ce qu'ils avaient prévu a réellement eu lieu, ils sont très heureux et clament "j'ai gagné!". Ils ne gagnent pas souvent et ils doivent écrire dans leur compte rendu que le résultat n'est pas celui qu'ils attendaient. Quelquefois, je vois de petits visages contrits et désappointés. Puis, ils jouent moins à"j'ai gagné", ils se donnent plutôt des conseils. L'enthousiasme pourrait mettre en péril les expériences : le verre est à transporter avec délicatesse pour ne pas être renversé par exemple.
2. Méthodes de travail : appliquer les consignes de rigueur et de présentation d'un travail.
a. La trace écrite : dessins et écriture
Les productions écrites varient beaucoup d'un enfant à l'autre.
Elles s'améliorent également avec le temps.
![]() Observation des
dessins :
Observation des
dessins :
le verre, au début carré, avec des angles ou pointu (en
triangle), se transforme. L'ouverture s'arrondit et s'évase, la base est
plus étroite. Quelques élèves ajoutent même un effet de volume.
l'eau d'abord indéfinissable, sous forme de traits de crayons, ou
d'un vague nuage au milieu du verre, occupe peu après toute la place qui
lui revient dans le verre. On observe également le niveau auquel elle
s'arrête.
le sucre peut être représenté sous forme d'un ou plusieurs
pavés aussi bien quand il est encore entier que quand il est dissout ou
bien même quand on le retrouve sec, collé et étalé au fond du verre.
D'autres dessinent la réalité sauf quand le sucre est dissout : ils
représentent de petits grains en suspension.
La position du verre par rapport au plan de travail : soit le verre
flotte au dessus du plan de travail, soit il est bien posé sur celui
ci.
![]() Observation de
l'écriture :
Observation de
l'écriture :
La date, la légende, la copie : Quelques élèves écrivent la
totalité des textes qui leur sont demandés. Certains n'écrivent rien
(surtout au début de l'année). D'autres abandonnent ou n'ont pas le
temps de finir.
c. Traitement de l'information : restituer et réorganiser les informations réunies.
A la rentrée des vacances de Noël, en janvier, avant que
certains élèves quittent le groupe d'adaptation, j'ai proposé aux
enseignantes de CP d'organiser une rencontre pour faire part aux groupes
classes des résultats obtenus lors de l'expérience sur la dissolution du
sucre.
J'ai donc demandé aux élèves de réaliser une affiche qui montrerait le
déroulement de la totalité de l'expérimentation. Pour cela, ils avaient
à leur disposition leur cahier d'expériences. Ils s'en sont surtout
servis pour retrouver et recopier les légendes. Le déroulement était
très clair pour eux. Ils n'ont pas eu de mal à se remémorer les
différentes étapes que nous avions suivies.
J'ai tout de même du les guider : "Qu'avons nous vu au début ? Puis
qu'avons nous remarqué ? Puis qu'avons-nous fait alors ? Et quel a été
le résultat final ? A chaque réponse, je leur proposais de faire
le dessin correspondant. J'ai ensuite pris le crayon pour écrire sous la
dictée leurs différentes explications.
Le plus dur a été d'expliciter la durée, le temps réellement passé
pour observer un élément nouveau et significatif : "longtemps,
six jours, cinq jours, quinze jours", personne n'était d'accord.
Ensuite, chacun s'est entraîné, avant le grand jour, à expliquer
l'affiche en manipulant verres, eau, sucre, devant le groupe d'adaptation.
L'exposé s'est bien passé. Ils ont manipulé et ont posé des questions à leurs camarades de classe. Ces derniers ont d'ailleurs réagi comme eux lors de notre première séance (représentations magiques, formule magique, utilisation d'une baguette magique)
C. Évolution des élèves en classe selon les compétences transversales observées en groupe d'adaptation
Je noterai donc pour chacun, l'évolution dans :
- les émissions d'hypothèse,
- les productions écrites (le cahier d'expérience)
- la restitution et la réorganisation des informations réunies.
Andrès
5 ans 11 mois
D'origine colombienne, Andrès confond le S-JE-CH à l'oral. La maîtresse se demande s'il comprend les consignes. Le test révèle une adaptation facile. Durant l'épreuve, Andrès lève souvent le bras pour demander la parole. Il est rapide pour effectuer le travail. Il finit avant ses camarades.
Carène ne comprend pas qu'il faut travailler. Le test révèle une adaptation facile. Durant l'épreuve, elle commence le travail avant que la consigne ne soit donnée et elle se trompe. Ensuite, elle est la dernière à finir.
Helmi a de grosses difficultés en graphisme et a beaucoup de mal à se mettre au travail. En lecture, il a du mal à mémoriser. Le test révèle une adaptation difficile et un soutien fort nécessaire. Lors du test, Helmi est sage, il rêve, il a des problèmes de compréhension des consignes. Il se lève pour regarder sur son voisin.
D'après ces observations, on peut voir que chaque enfant suit un cheminement à peu près identique. Il doit d'abord maîtriser le dessin puis le schéma pour s'investir dans l'écriture proprement dite. Il semblerait qu'à partir du moment où il a acquis ces compétences, il soit disponible mentalement pour émettre des hypothèses.
C'est à partir de la première émission d'hypothèse faisant intervenir des variables et non basée sur des faits que je qualifierai de magiques, que l'enfant évolue véritablement au sein du groupe classe et peut se concentrer sur l'apprentissage de la lecture. C'était le cas de Stéphanie, d'Alexandra et de Loïc au mois de janvier. Bien qu'Armand ait réagi pareillement, nous avons préféré le garder en groupe d'adaptation jusqu'aux vacances de février pour l'accompagner dans son second CP (ce qui avait aussi pour effet de rassurer son institutrice).
Radouane, Andrès et Helmi n'ont pas encore atteint le niveau de l'émission d'hypothèse. Dans le groupe classe :Andrès est en phase de régression et Radouane ne progresse pas. Par contre, Helmi qui nécessitait un soutien fort nécessaire en octobre commence à lire correctement. Il se lance également dans la production d'écrits.
Carène lit et écrit très bien lorsqu'elle est isolée du groupe. De plus elle est très pertinente lorsqu'elle prend la parole. La présence de ses camarades la perturbe et dans ce cas là ses productions sont médiocres. J'en ai discuté lors d'une synthèse réseau et nous en avons conclu qu'une prise en charge par la ré éducatrice lui serait profitable. La prise en charge G a démarré au début du mois de mars.